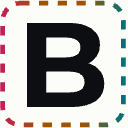Salvatore Guadagnino : quand l’accessibilité devient une évidence
6 minutes de lecture passionnante !
Publié le 3 septembre 2025 par Mélanie Coltel

Enseignant, formateur et consultant en accessibilité numérique et écoconception, Salvatore Guadagnino partage son expérience et son engagement envers l’accessibilité numérique, fruit de son parcours personnel et professionnel.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Salvatore Guadagnino et j’ai eu plusieurs vies professionnelles. Pendant les 25 premières années de ma carrière, j’ai été réalisateur de documentaires pour la télévision, ce qui m’a permis de voyager et de rencontrer une multitude de personnes.
En 2015, j’ai entamé une reconversion dans la communication web. Et c’est là que j’ai découvert l’accessibilité numérique, un peu par hasard au départ, en travaillant comme community manager. Mais ce sujet a vite pris tout son sens pour moi : je me suis d’abord formé en autodidacte avant de suivre des formations plus structurées sur l’audit et la sensibilisation à l’accessibilité numérique.
Aujourd’hui, je suis consultant, auditeur et formateur en accessibilité. J’ai également co-créé l’association Digital Handicap à travers laquelle nous réalisons des tests utilisateurs en situation de handicap, mais aussi des formations sur l’accessibilité au sein d’entreprises et d’écoles.
Mon engagement trouve aussi ses racines dans mon histoire personnelle : certains membres de ma famille proche ont vécu ou vivent encore avec un handicap, j’ai moi-même été aidant pendant plusieurs années. Ça m’a naturellement amené à m’investir pleinement dans cette mission.
En quoi votre expérience dans l’audiovisuel a-t-elle influencé votre façon d’aborder l’accessibilité aujourd’hui ?
Étant dyslexique et dysorthographique, j’ai longtemps eu du mal à m’exprimer via l’écrit. À l’école, à une époque où ces troubles étaient mal compris, j’étais souvent mis de côté. J’ai appris à me taire, à ne pas déranger… et j’en suis sorti avec de vraies lacunes.
La vidéo m’a offert un autre langage. Elle m’a permis de raconter des histoires sans passer par l’écriture. C’était pour moi une manière de m’exprimer pleinement, autrement. Et sans le savoir, j’avais déjà un pied dans l’accessibilité : je cherchais à rendre mes films simples, compréhensibles et accessibles.
Avec le temps, j’ai naturellement intégré des pratiques comme l’audiodescription ou les sous-titres à mes vidéos. Je ne le faisais pas encore de façon consciente, mais c’était déjà une forme d’accessibilité. Et aujourd’hui, ça me paraît évident !
Finalement, ce lien entre image, narration claire et accessibilité a toujours fait partie de mon approche.
Une expérience marquante à partager ?
J’en ai eu plusieurs, mais ce qui me marque le plus, ce sont les moments où je vois de véritables prises de conscience chez les étudiants. Je pense notamment à une intervention dans une école du web. On a commencé simplement, en leur demandant de fermer leurs ordinateurs et d’écouter une histoire : celle du handicap. Au début, ils étaient un peu sceptiques. Et puis, au fil de la présentation, quelque chose s’est passé. Ils ont commencé à comprendre, à s’interroger, à prendre conscience de l’importance de l’accessibilité.
Une autre expérience marquante, c’est lorsqu’on a fait tester des prototypes d’étudiants à des personnes en situation de handicap. Voir leurs projets testés en conditions réelles, par des personnes touchées par le handicap, ça change tout. Certains ont eu un réel déclic. La directrice de l’école s’est même déplacée pour assister à ces échanges ! Et à la fin, plusieurs étudiants sont venus me dire que ça avait changé leur regard, que ça leur avait ouvert les yeux.
C’est ça qui me touche le plus : quand je vois que le déclic se fait. Quand ils comprennent que l’accessibilité, ce n’est pas une case à cocher, mais une façon de penser dès le départ. Je leur dis toujours : “Mettez du sens dans ce que vous faites.” Une fois que le sens est là, les bons réflexes suivent naturellement.
Quels obstacles rencontrez-vous encore aujourd’hui dans l’usage du numérique ?
Je rencontre plusieurs obstacles au quotidien, principalement liés à ma dyslexie. Ce qui me gêne le plus, c’est la manière dont l’information est présentée sur certains sites. Souvent, il y a du contenu mal structuré, mal formulé, ou dispersé dans des menus complexes. Et quand les textes sont trop longs ou mal organisés, je me perds. Ça demande un effort énorme pour simplement comprendre ce qu’on essaie de me dire. Trop de texte, ça noie l’essentiel.
Autre point important : la typographie. Même si ça s’améliore, certaines polices restent difficiles à lire. C’est pourquoi j’utilise au quotidien des polices comme Luciole, Atkinson Hyper Legible, ou Verdana.
Quand l’accès à l’information demande trop d’énergie ou de concentration, c’est simple… Je quitte le site. Et je pense que beaucoup font pareil. L’accessibilité, c’est aussi ça : permettre de comprendre sans effort inutile.
En tant que formateur, quelles résistances ou incompréhensions rencontrez-vous le plus souvent ?
Il y a deux grandes idées reçues qui reviennent souvent pendant mes formations.
La première, c’est : “Pourquoi ne pas faire un site à part pour les personnes handicapées ?” Je leur explique alors qu’il existe plusieurs handicaps : visuel, auditif, moteur, cognitif… Si on va au bout de cette logique, ça voudrait dire un site pour chaque profil, ce qui est absurde. Et surtout, pourquoi exclure encore une fois les personnes concernées du site “classique” ? Ça revient à du validisme.
L’autre idée reçue, c’est : “Tout ça pour si peu de monde…” Et là, je ne cherche pas à culpabiliser, mais à faire comprendre, à déconstruire, à sensibiliser. J’explique l’histoire du handicap, les lois, la discrimination systémique. Lors de mes formations, il y a déjà eu ce type de débat. Et ce qui est beau, c’est quand les étudiants prennent le relais entre eux. Ils argumentent, ils défendent l’accessibilité, et ça donne lieu à des discussions profondes.
On ne convainc pas tout le monde, mais on a le pouvoir de semer des petites graines par-ci, par-là ! Et parfois, ce sont nos camarades qui les font germer.
Comment favoriser la co-construction avec les personnes en situation de handicap ?
Trop souvent, on confond conformité et accessibilité. Mais l’accessibilité, la vraie, passe par les personnes concernées. C’est pourquoi, dans notre association, on travaille avec un panel de 40 testeuses et testeurs en situation de handicap. Ils interviennent très tôt, même sur des maquettes, pour vérifier si l’expérience proposée fonctionne vraiment pour eux.
Le test utilisateur permet d’avoir un retour humain, concret et vécu. Et au final, c’est ça, la vraie co-construction ! Intégrer les usagers, pas à la fin, mais dès le départ.
Que pensez-vous de l’utilisation de l’IA dans l’accessibilité ?
L’IA peut être un bon appui, notamment pour la traduction automatique, la génération d’alternatives textuelles ou la simplification de contenu. Ce n’est pas encore parfait, mais ça progresse vite, et je trouve ça intéressant à explorer, surtout pour faciliter certains usages.
En revanche, je ne crois pas qu’elle puisse remplacer l’analyse humaine ou les tests utilisateurs, du moins pas aujourd’hui. L’accessibilité, c’est aussi une question de sensibilité et de contexte. On ne peut pas l’automatiser entièrement, on a besoin de l’humain derrière.
Avez-vous des projets futurs pour améliorer la formation à l’accessibilité ?
Oui, c’est une idée qu’on porte avec notre association Digital Handicap, et qui nous tient énormément à cœur : créer une école entièrement centrée sur l’accessibilité numérique.
L’objectif, ce n’est pas de former seulement les développeurs ou les designers, mais de former de véritables chefs de projet “couteaux suisses” :
- aux fondamentaux du code, du design, de l’UX, du test utilisateur, et de la gestion de projet ;
- aux bonnes pratiques de l’accessibilité et à ses enjeux, à la langue des signes, etc.
L’idée, c’est qu’à la fin de notre licence de 3 ans, les diplômés soient capables de dialoguer avec toutes les parties prenantes, et surtout de repérer les problèmes d’accessibilité dès la conception, en design comme en développement.
Mais ce qui rendra notre école vraiment spécifique, c’est notre approche inclusive. On souhaite intégrer au moins 50 % de personnes en situation de handicap, que ce soit parmi les étudiants ou les formateurs. Parce qu’apprendre aux côtés d’un camarade non-voyant ou sourd, ce n’est pas juste sensibiliser : c’est vivre concrètement l’accessibilité, et la rendre naturelle.
On prévoit aussi d’adapter tout le campus aux différents types de handicaps, pour que personne ne soit laissé de côté. Ce projet, c’est notre façon de contribuer à un monde plus accessible.
Quel conseil donneriez-vous à un professionnel hésitant à intégrer l’accessibilité dans son projet ?
Finalement, l’accessibilité, c’est surtout une question de bon sens. Chaque ligne de code, chaque choix de design a un impact direct sur l’utilisateur final. Penser accessibilité dès le départ, c’est gagner du temps, de l’argent, et proposer une meilleure expérience pour tout le monde.
En France, 12 millions de personnes sont concernées par le handicap. Si on n’intègre pas au moins un ou deux personas en situation de handicap dès la conception, on exclut d’emblée une partie du public, et donc du marché.
Mon conseil serait donc de donner du sens à ce que vous faites et de mettre l’humain en avant. Quand on comprend pourquoi on agit, l’accessibilité devient une évidence, pas une obligation !
Pour aller plus loin…
Si vous souhaitez mettre en place des actions pour favoriser l’inclusion et l’accessibilité numérique, mais que vous ne savez pas par où commencer, demandez conseil à nos experts accessibilité via l’adresse mail contact@warren-walter.com. 💡
Et pour plus d’informations sur nos prestations en accessibilité, on vous donne rendez-vous sur notre page dédiée à l’Accessibilité Numérique. 🧐